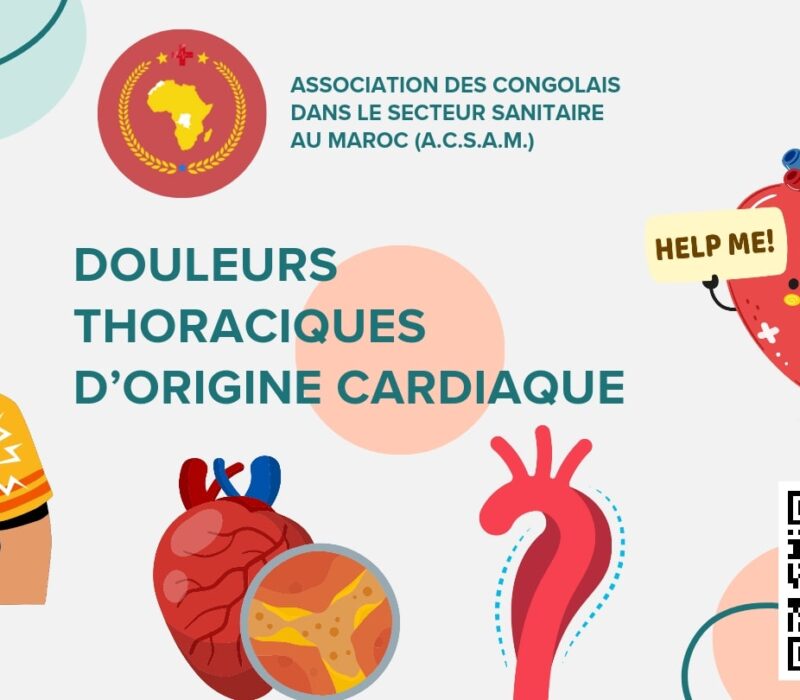La néphropathie lupique est une complication sévère du lupus érythémateux systémique (LES), une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire attaque les propres tissus de l’organisme. Cette complication affecte perturbe la capacité de filtration des reins et conduisant à des lésions potentiellement graves.
Le LES touche en moyenne entre 20 et 150 personnes sur 100 000, avec une prédominance marquée chez les femmes, qui représentent environ 90 % des cas. Les femmes âgées de 20 à 40 ans sont les plus souvent concernées par cette pathologie.
Comprendre ce que c’est que le LEAD
Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-immune systémique, c’est-à-dire qu’elle peut affecter pratiquement tous les organes du corps. Elle est caractérisée par la production d’anticorps dirigés contre les propres antigènes de l’organisme, entraînant une réponse immunitaire inappropriée.
Les causes exactes du LES sont encore mal comprises, mais plusieurs facteurs sont impliqués dans son déclenchement et son évolution. Parmi ces facteurs, on retrouve :
- La génétique : une prédisposition familiale peut augmenter le risque de développer la maladie.
- L’environnement : l’exposition aux rayonnements UV du soleil, certains médicaments et infections virales peuvent déclencher ou aggraver les symptômes.
- Des facteurs endogènes : les hormones, notamment les œstrogènes, jouent un rôle dans l’aggravation de la maladie, expliquant en partie pourquoi le lupus est plus fréquent chez les femmes, en particulier durant les périodes de fluctuations hormonales (puberté, grossesse).
Ainsi, le LES résulte d’une interaction complexe entre ces différents facteurs, déclenchant une attaque du système immunitaire contre les cellules et tissus sains de l’organisme.
Pour simplifier la physiopathologie, l’un des scénarios acceptés est le suivant :
Suite à une exposition aux rayonnements UV, notamment ceux du soleil, l’ADN des cellules peut subir des dommages, ce qui provoque la mort cellulaire et le relargage des composants nucléaires. L’organisme active alors un processus de nettoyage pour éliminer les corps apoptotiques, c’est-à-dire les cellules mortes. Cependant, si ce système de détersion devient défaillant, ces corps apoptotiques s’accumulent, ce qui déclenche une réponse immunitaire.
Les cellules immunitaires, notamment les lymphocytes B, sont alors activées et se transforment en plasmocytes, produisant des anticorps dirigés contre les composants relargués par les cellules détruites. Ces anticorps forment des complexes immuns avec les antigènes libérés. L’accumulation de ces complexes dans les tissus déclenche une inflammation, conduisant à une variété de symptômes caractéristiques du lupus érythémateux disséminé (LED).
Ce mécanisme auto-immun résulte de l’incapacité de l’organisme à éliminer efficacement les débris cellulaires, ce qui entraîne une production inappropriée d’anticorps et une inflammation chronique.
La Néphropathie lupique
La néphropathie lupique est l’une des complications les plus graves du lupus érythémateux systémique (LES), touchant principalement les glomérules, qui sont les unités de filtration des reins. Dans cette affection, des complexes immuns se forment et se déposent au niveau des glomérules, déclenchant une réponse inflammatoire. Cette inflammation perturbe la fonction rénale, endommageant la structure glomérulaire et entraînant des pertes anormales de protéines (protéinurie) et parfois de globules rouges (hématurie) dans les urines.
La néphropathie lupique peut évoluer vers une insuffisance rénale si elle n’est pas traitée. En moyenne, 40 à 75 % des personnes atteintes de lupus développent cette complication, ce qui en fait une manifestation fréquente et préoccupante de la maladie.
Examen Clinique & examens complémentaires
Cliniquement la Néphropathie lupique peut être se manifester par les éléments suivants :
- Bandelette urinaire : une protéinurie ou une hématurie
- Un syndrome néphrotique impur (Lire l’article sur les néphropathies glomérulaires) avec sédiment urinaire actif (présence des cellules)
- Syndrome néphritique : HTA
En complément des bilans complémentaires peuvent être faits en l’occurrence :
- Urée/Créat : à la recherche d’une insuffisance rénale
- Hémogramme : à la recherche d’une anémie, une thrombopénie ou une leucopénie
- Dosage du complément sérique : on peut observer une baisse des fractions du complément
- Recherche d’auto-anticorps : Anti-DNA, Anti-nucléaires…
- Recherche d’anticoagulants lupiques
La ponction-biopsie rénale joue un rôle central dans l’évaluation de la néphropathie lupique. Ce geste médical présente plusieurs intérêts :
- Diagnostique : identifier précisément le type et l’étendue des lésions rénales, ce qui est essentiel pour affiner le diagnostic.
- Pronostique : la biopsie permet d’évaluer la sévérité des lésions rénales, ce qui aide à prédire l’évolution de la maladie et à déterminer les risques de progression vers une insuffisance rénale terminale.
- Thérapeutique : en identifiant le type de lésions rénales, la biopsie oriente le choix du traitement le plus approprié, qu’il s’agisse d’immunosuppresseurs, de corticostéroïdes ou d’autres approches thérapeutiques.
Un aspect important de la néphropathie lupique est l’absence de corrélation anatomoclinique. Cela signifie qu’il n’y a pas toujours de correspondance entre les symptômes cliniques et la gravité des lésions rénales observées à la biopsie. En d’autres termes, une atteinte rénale sévère peut survenir même en présence de symptômes cliniques minimes, d’où l’importance cruciale de la biopsie pour évaluer la gravité réelle de la maladie.
Classification histologique
La néphropathie lupique est classée en fonction de la sévérité et du type de lésions glomérulaires, selon la classification de l’International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS). Il existe six classes de néphropathie lupique :
- Classe I – Glomérulonéphrite mésangiale minimale : lésions rénales légères, souvent sans symptômes cliniques significatifs.
- Classe II – Glomérulonéphrite mésangiale proliférative : légère prolifération des cellules mésangiales avec de la protéinurie, mais une fonction rénale souvent préservée.
- Classe III – Glomérulonéphrite proliférative focale : lésions touchant moins de 50 % des glomérules, avec des signes d’inflammation et de dépôts d’auto-anticorps.
- Classe IV – Glomérulonéphrite proliférative diffuse : lésions sévères affectant plus de 50 % des glomérules, souvent associées à une insuffisance rénale progressive et une protéinurie sévère.
- Classe V – Glomérulonéphrite extramembraneuse : dépôts d’auto-anticorps le long de la membrane basale glomérulaire, entraînant un syndrome néphrotique avec des œdèmes, une protéinurie massive, et des risques élevés de thrombose.
- Classe VI – Glomérulonéphrite sclérosante avancée : cicatrisation extensive des glomérules, souvent irréversible, avec une progression vers l’insuffisance rénale terminale.







Attitude thérapeutique
En fonction du stade d’évolution de la pathologie, le traitement vise essentiellement à contrôler l’inflammation et à prévenir les dommages rénaux permanents.
Les options incluent :
- Corticothérapie :
- Immunosuppresseurs (cyclophosphamide, mycophénolate mofétil, azathioprine) : pour freiner la réponse auto-immune.
- Inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus, ciclosporine) : utilisés dans certains cas.
A cela peut s’associer d’autres mesures :
- Antihypertenseurs : pour contrôler la pression artérielle et limiter les dommages rénaux.
- Néphroprotection : pour réduire la protéinurie.
- IEC : Bloqueurs du système rénine-angiotensine (inhibiteurs de l’ECA ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine) :
- ARA II
Quelles sont les complications possibles ?
Si la maladie n’est pas bien contrôlée ou si elle progresse malgré le traitement, La Néphropathie Lupique peut entrainer des complications telles que :
- Insuffisance rénale chronique
- Syndrome Néphrotique
- Complications cardiovasculaires
- Thromboses
- Ostéoporose et ostéonécrose
- Anémie
- Hypertension artérielle
- Déséquilibres électrolytiques
- Complications liées aux traitements
Facteurs de mauvais pronostic
Dans l’évolutivité d’une néphropathie lupique, certains facteurs peuvent éventuellement prédire un mauvais pronostic pour le patient en l’occurrence :
- Persistance de la protéinurie
- Sédiment urinaire actif
- HTA
- Insuffisance rénale au moment de la biopsie
- Race noire, sexe masculin.
Pour résumer
La néphropathie lupique est la manifestation rénale du lupus érythémateux disséminé (LED), classée en six types distincts selon l’atteinte glomérulaire observée à la biopsie rénale. Chaque classe correspond à un degré différent de sévérité et nécessite une approche thérapeutique spécifique visant à traiter l’inflammation sous-jacente et à prévenir la progression de la maladie rénale.
La prise en charge des patients avec néphropathie lupique inclut de la corticothérapie, des immunosuppresseurs, mais aussi des mesures de protection rénale telles que la gestion de la pression artérielle et la réduction de la protéinurie. Une surveillance étroite et régulière par un néphrologue est essentielle pour ajuster le traitement en fonction de l’évolution de la maladie et des éventuels effets secondaires des thérapies. Cette approche vise à prévenir les complications rénales graves, comme l’insuffisance rénale terminale, et à améliorer à la fois le pronostic et la qualité de vie des patients.
Sources :
- Hôpitaux universitaires de Genève,
- LE MANUEL MSD
- Pr. DOMINIQUE CHAUVEAU (Néphrologue)
- High-Yield Notes by Medicalstudyzone.com